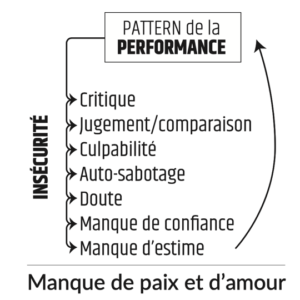Vous dirigez Maisons du monde depuis juillet 2018. Que signifie le « management inclusif » pratiqué par votre entreprise ?
Un management inclusif repose avant tout sur une entreprise à l’écoute, qui sait que sa valeur vient des femmes et des hommes qui la composent, en particulier dans le secteur de la vente au détail qui est le sien. La diversité est une force, et de là vient la plus grande performance de Maisons du monde, une entreprise très féminine : deux tiers de nos collaborateurs sont des femmes, celles-ci dirigent trois quarts des magasins et constituent la moitié du comité exécutif. L’entreprise souhaite comprendre et incarner au quotidien la richesse de la diversité. C’est une responsabilité de tous les jours et de chacun que de promouvoir et de préserver celle-ci.
Auparavant, vous étiez la directrice digital et marketing client de l’entreprise. Pourquoi vous êtes-vous portée candidate à ce poste et qu’est-ce qui a fait la différence, selon vous ?
Je connaissais Maisons du monde depuis 2014. Le numérique faisant partie de son évolution depuis de nombreuses années, on voyait bien l’accélération du modèle dans ce sens. J’ai donc participé à l’introduction en Bourse de l’entreprise, en 2016, aux côtés du directeur général de l’époque. En 2018, alors que j’avais trois enfants en bas âge, ce n’était pas un choix évident, mais j’avais un projet pour Maisons du monde. Cette entreprise était tellement attachante, avec des femmes et des hommes très engagés, que je me suis lancée. Je pensais que je pouvais entretenir notre longueur d’avance sur le digital. Je souhaitais aussi faire évoluer certains pans de l’organisation, par exemple, donner un nouvel élan à l’offre, poursuivre la croissance rentable, en y combinant plus de « responsabilité ».
L’emploi du temps d’une DG est dense. Avez-vous mesuré les contraintes, les obligations quand vous avez candidaté à ce poste, en tant que mère de famille habitant à Paris et non à Nantes, où se situe le siège ?
Je crois que l’on ne mesure jamais toutes les données avant d’y arriver… Surtout dans un secteur qui se transforme rapidement et dans un contexte macroéconomique qui a tout de même bougé ces derniers temps. Je crois aussi que, dans la vie, il faut réfléchir… mais pas trop. Je me suis fiée à mon intuition. Pour prendre ce type de responsabilités, cela demande beaucoup d’engagement : il faut avoir un projet et qu’il vous passionne. J’ai pu me lancer dans cette aventure, car mon mari, qui a lui aussi une carrière très remplie, a su et voulu réorienter ses responsabilités au sein de notre famille. Il s’est organisé dans un périmètre plus local, il a moins voyagé. Et cela a finalement enrichi notre expérience familiale.
La famille reste votre priorité…
Oui, mon mari et moi-même nous sommes donné quelques petites règles familiales. Je ne passe jamais plus de deux nuits consécutives hors de mon foyer. Chaque jour, nos enfants sont réveillés ou couchés par l’un de nous deux. Aux vacances scolaires, je prends une semaine de congé et j’encourage les membres du comité exécutif et les collaborateurs de l’entreprise à en faire de même. Vous savez, ce n’est pas très sain de créer une distinction entre le corps dirigeant et le reste des collaborateurs. C’est justement parce que ces derniers me voient avec les mêmes problématiques qu’eux, comme des réunions zoom avec mon fils de trois ans sur les genoux, que cela permet de créer une atmosphère détendue, de dire les choses quand cela ne va pas ou le contraire.
Vous parlez avec beaucoup de sincérité de cette répartition entre vos deux « vies ». C’est assez rare dans le monde des grands dirigeants. C’est un choix assumé ?
Les collaborateurs de l’entreprise se donnent beaucoup. En tant que dirigeante, je me dois, en retour, de donner du sens à leur travail et de leur accorder de la confiance. Et cela passe par une attitude transparente. J’aime beaucoup ce proverbe africain : « It takes a village to raise a child », « Il faut un village pour élever un enfant ». Cela signifie que tout le monde a un rôle à jouer dans l’aventure et que des liens authentiques, fondés sur la transparence et l’entraide autour d’une vision commune, conduisent à une culture forte et, je le crois, au succès.
Avez-vous dû faire face à quelques réticences ? Avez-vous senti que vous deviez faire vos preuves ?
Cette question m’est régulièrement posée et, étonnamment, on la pose beaucoup plus aux femmes qu’aux hommes. L’idée est d’assumer pleinement ce que l’on est, sans tomber dans les excès. Je crois que mon rôle de maman et ma vie personnelle m’aident à être une meilleure dirigeante. Car cela m’oblige à prioriser, à donner un cadre très clair aux équipes. Celles-ci doivent être efficaces parce que, moi-même, j’ai besoin d’être efficace. Cela remet aussi l’église au centre du village (toujours lui !) : quand, dans ma vie professionnelle, il m’arrive d’être tendue, la famille me rappelle la vraie valeur des choses et le sens des priorités. Enfin, il me semble important de montrer aux femmes de l’entreprise qu’il ne leur est pas nécessaire d’afficher la panoplie du super-héros dévoué à sa carrière : je gère, je n’ai aucune contrainte extraprofessionnelle, etc. La vie pour moi est faite de vases communicants. L’important est de conserver un engagement et une exigence élevés. Pour le reste, l’adaptabilité est ma meilleure amie. Moins on se met de barrières mentales sur ce que l’on peut et ne peut pas, plus on a de chances de réussir sa vie professionnelle.
La bonne gestion de cet équilibre pro-perso est un moteur formidable : pourquoi n’en avait-on pas conscience auparavant ?
Parce que le travail était vu comme une fin en soi. Pendant longtemps, on a évolué dans des valeurs masculines assez fortes : la réussite professionnelle avait une fonction statutaire importante. Ce n’était pas le cas dans toutes les sociétés européennes. En Scandinavie, par exemple, c’est tout à fait différent. On avait auparavant une vision très linéaire de la vie des gens, avec des études, un travail… Les générations actuelles nous apprennent à cultiver plus de circularité, avec plus d’équilibre entre les différents pans de notre existence. Et c’est tant mieux !
Les grands mots de cette année sont « flexibilité » et « agilité ». J’ai entendu dire que vous demandiez à vos collaborateurs de faire preuve d’une grande efficacité dans les réunions, mais aussi de travailler en autonomie…
L’autonomie est une valeur forte chez nous, car Maisons du monde est une entreprise entrepreneuriale. Notre mode de fonctionnement est « agile », dans le sens où nos salariés sont engagés dans les projets et les portent. L’année 2020 a été particulière : je n’ai pas demandé plus d’efficacité à mes équipes, car elles se sont adaptées seules. En tant que dirigeante, j’ai un devoir de vigilance avec mon comité exécutif afin de ne pas privilégier la productivité avant tout.
Les entreprises sont davantage des lieux moraux que physiques. Comment vous adaptez-vous ?
Il faut arriver à préserver et à renforcer la culture d’entreprise. Nous sommes passés à deux jours de télétravail par semaine. Nous n’avons pas souhaité aller plus loin, car le temps collectif est essentiel pour l’aspect interrelationnel, pour les espaces de liberté induits, pour favoriser la créativité, une valeur importante chez nous. Ces valeurs d’entreprise définissent le quotidien entre les équipes et le management de proximité. Le comité exécutif et moi-même réfléchissons à valoriser ces temps d’interaction, en présentiel mais aussi à distance. À l’occasion de 2020, nous avons lancé une initiative nommée les MDMTalks : le comité exécutif prend la parole auprès de l’ensemble des collaborateurs du siège et des magasins, directeurs et adjoints. On discute de l’actualité de l’entreprise, des difficultés qui sont les nôtres. On met le plus possible en lumière d’autres collaborateurs de l’entreprise. Le discours de transparence, l’échange sur la base d’un jeu de questions-réponses sont au cœur de cet exercice. Je trouve que le Covid nous a permis de cultiver des liens rapprochés avec nos collaborateurs, avec nos équipes en magasin. Quand on a 350 sites en Europe, on ne peut pas avoir la même proximité tout le temps.
Comment le numérique peut-il nous amener à développer toujours plus de proximité, sans se substituer à la qualité du temps physique en entreprise ?
Avant de prendre mes fonctions, j’ai fait durant trois mois le tour des magasins en Europe, visité plus de 70 sites, participé à 40 dîners avec des directeurs régionaux et de magasins, ce qui m’a permis de sentir le pouls de l’entreprise. Aujourd’hui encore, ces interactions me portent. J’accorde énormément d’importance à la voix de nos équipes en magasin, qui sont au contact de nos clients. À chaque événement, confinement, déconfinement, période de Noël ou autre, le comité exécutif et moi-même étions présents en magasin. C’est important d’aller cultiver le lien vivant : le numérique ne fait pas tout, loin de là.
Vous êtes vue sur les sites, vous privilégiez le tutoiement : la perception du PDG a-t-elle changé ?
La simplicité de la relation avec le management est, pour moi, la base du rapport de confiance qu’il est possible de nouer avec les collaborateurs. J’ai commencé ma carrière dans des entreprises américaines, donc, probablement, cela laisse des traces. Je tutoie tous les collaborateurs et vice versa. Je pose naturellement beaucoup de questions, car c’est en interrogeant des collaborateurs à plein de niveaux différents que je construis ma perception de ce que doit être l’entreprise de demain. Je vais au contact de façon très large. Le fait de rendre le management accessible est important, d’autant plus dans cette période. Cela passe par la communication. On doit s’appuyer sur un management de proximité pour que chacun endosse la responsabilité de donner du sens à son collaborateur. Le devoir d’exemplarité est pour cela essentiel.
Quels sont vos grands projets à la tête de Maisons du monde ?
Poursuivre la croissance et y associer plus de durabilité. Ce projet a un soubassement RH très important, car la durabilité porte un pan social et un pan environnemental. Nous sommes une marque-enseigne et nous avons une affinité très forte avec nos clients. Cette marque passe par notre offre. Nous avons donc à cœur de faire croître nos équipes de création. Au-delà du côté tendance et stylé, il faut donc miser sur la durabilité : par exemple, 68 % de notre offre en bois est certifiée. On a lancé pour la première fois du textile certifié Oeko-Tex. En une année, on a atteint 25 % de notre offre textile certifiée de la sorte. On fait la combinaison entre « aller chercher des produits qualitatifs avec un double enjeu d’expérience clients et de durabilité » et « aller chercher des matières toujours plus responsables ». Le produit reste au cœur de nos modèles. S’agissant de l’approche « omnicanal » – qui vise à multiplier les interactions avec le consommateur, à l’heure où le digital prend de plus en plus de place –, l’idée est de continuer à accélérer dans ce sens, mais en affirmant toujours l’importance du magasin, qui crée beaucoup plus de valeur qu’une simple transaction numérique. Tout l’enjeu est de faire évoluer le rôle du magasin dans un modèle omnicanal, avec une marque forte, vers un point de vente qui offre une expérience et un service.
Enfin, notre dernier pan de croissance s’appuie sur le développement des services. En 2019, nous avons pris une participation majoritaire dans Rhinov, une start-up qui fait du conseil professionnel en décoration d’intérieur, 100 % numérique. Ce sont des architectes d’intérieur : vous leur soumettez le petit quiz déco que vous avez rempli, un budget pour votre pièce, et là vous avez des planches déco réalisées par de vrais professionnels. Nous avons l’ambition de démocratiser la déco. Par les produits, bien sûr, mais aujourd’hui aussi par les services. C’est un axe de création de valeur pour nos clients, et c’est aussi une création de valeur durable, qui ne nécessite pas de produire de la matière supplémentaire.
Justement, vos intérêts pour les problématiques de RSE sont connus : comment sont-ils incarnés dans Maisons du monde ?
Avez-vous une feuille de route en fonction de ces engagements ?
Oui, s’agissant de l’offre, nous sommes concentrés sur plus d’écoconception, plus de matériaux recyclés ou durables. Plus de réparation aussi : nous avons un atelier d’ébénisterie dans nos entrepôts, avec des artisans qui réparent les produits pour éviter qu’ils ne soient jetés. Ainsi 18 000 meubles ont été remis à neuf cette année. C’est deux fois plus qu’en 2020. De même, Maisons du monde se situe dans une économie circulaire et solidaire : nous sommes l’un des premiers partenaires d’Emmaüs, à qui nous donnons des dizaines de milliers de produits à l’état neuf issus des retours de nos clients, afin de leur offrir une seconde vie.
Dans la thématique de la durabilité, le pôle social est important : comment les collaborateurs sont-ils associés à cet effort ?
Maisons du monde est une entreprise qui crée du profit : notre responsabilité est donc de dégager des contributions dans un système positif. Être collaborateur de Maisons du monde, c’est faire partie d’une entreprise où chaque personne compte, c’est se sentir nécessaires les uns aux autres, construire ensemble une entreprise qui ressemble à ses équipes et les rassemble, c’est avoir la liberté d’être soi-même et avoir la conscience intime d’être au bon endroit. Pour faire vivre cet esprit, notre politique RH allie une proposition adaptée à chaque étape clé du parcours des collaborateurs et des engagements sociaux forts. Nous ambitionnons de créer une école de formation et de devenir une entreprise apprenante pour tous ceux qui partagent les valeurs de la marque. Par ailleurs, Maisons du monde souhaite être un employeur de référence grâce à des engagements responsables forts. Une feuille de route a été formalisée en matière de bien-être, d’inclusion des personnes en situation de handicap et des jeunes, d’égalité hommes-femmes, de dialogue social.
Pour une expérience collaborateur optimale, le management de proximité est essentiel…
Justement, le groupe a décidé d’intégrer à sa feuille de route RSE des objectifs RH sur le renforcement du management de proximité et sur l’amélioration des conditions de travail pour les équipes. Ce plan d’action s’enrichit des retours des collaborateurs collectés lors de l’enquête sociale réalisée en septembre 2019 et renouvelée tous les deux ans. La hiérarchie présente sur place est un élément clé pour mieux accompagner les collaborateurs. Dans cette optique, la formation des cadres est essentielle. Chaque année, un plan spécial est déployé avec des modules où l’on apprend l’importance de créer des rituels managériaux ou commerciaux pour diffuser l’information et mobiliser les équipes. De même, dans un souci de proximité, les équipes ont été dimensionnées à taille « humaine », cette organisation ayant pour conséquence le renforcement du nombre de managers de proximité afin de garantir une meilleure connaissance des équipes et une amélioration de la qualité de la relation de travail.
J’entends une forme d’aplanissement de la hiérarchie, un management de proximité renforcé, des solutions apportées aux problématiques RSE, des avancées en matière d’inclusion : tous ces éléments contribuent-ils à construire des valeurs attrayantes pour les plus jeunes ?
Pour tous ! Nos valeurs d’audace, de passion, d’engagement et d’exigence sont illustrées ainsi. Notre « raison d’être » est en cours de construction, il est aujourd’hui temps de la formaliser et de lui apporter des éléments de preuve à travers des plans d’action dans tous les métiers. Nous souhaitons que cette raison d’être s’incarne et se vive au quotidien. Nous avons tous besoin de sens au travail. Aujourd’hui, plus que jamais.
Quelles seront les tendances QVT de demain ?
Le télétravail est là pour durer, même s’il l’est de façon mesurée. Nous passerons donc plus de temps à la maison. Nous chercherons également du sens dans l’activité et l’expérience professionnelle au sens large. Un nouvel équilibre devra être trouvé, entre métier et vie personnelle, entre productivité et déconnexion. Et sur le lieu de travail même, le bureau devra être repensé, les rythmes également. Le temps collectif pourrait être réservé à la création, à l’innovation et au développement des liens entre collaborateurs. La culture devra être renforcée, car ce sera le liant de la société. Les manageurs de demain devront appréhender ces réalités dans une démarche holistique